Les mutations de l'enseignement supérieur en Afrique : le cas de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Abdou Salam Sall, éditions l'Harmattan Sénégal, Dakar, 2012.
Abdou Salam Sall, professeur de chimie inorganique à l'UCAD, doyen de la faculté des sciences et techniques et recteur de l'UCAD durant sept ans, publie un ouvrage d'analyse sur les mutations de l'enseignement supérieur. Son témoignage et son expérience en font un ouvrage de référence.
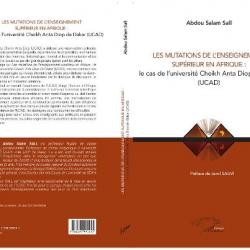

Mener une politique de changement dans l’enseignement supérieur : l’UCAD à Dakar/ Sénégal[i]
Pôle universitaire central de l’Afrique de l’Ouest, l’UCAD a été créée en 1957 par le gouvernement français et s’appelait alors « l’Université de Dakar ». En 1986, à la mort du professeur Cheikh Anta Diop, elle devient l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Université destinée à l’ensemble des pays d’Afrique francophones, celle-ci était le reflet de l’enseignement supérieur français. Puis le désengagement progressif des enseignants français a permis de mettre en place un véritable programme d’africanisation des enseignements de l’UCAD. Pour autant, une véritable réforme de l’institution sera nécessaire pour faire vivre cette immense structure, une des plus grandes de l’Afrique de l’Ouest.
Plusieurs projets sont engagés dans les années 90 afin d’améliorer les parcours universitaires au sein de l’UCAD. La priorité était de mettre en adéquation les diplômes délivrés par l’UCAD (de BAC +2 à BAC +12) à la réussite d’une insertion professionnelle fiable au niveau national. L’autre point important était de réguler le flux, en progression constante, des étudiants, à la fois en terme d’encadrement pédagogique mais aussi en terme d’accueil et d’équipement des infrastructures. L’UCAD connait alors des perturbations fréquentes liées aux multiples dysfonctionnements, des grèves à répétition s’organisent par l’ensemble des acteurs de la faculté. Autre problématique, liée au fonctionnement héritée de la gestion française, est de développer le secteur de la recherche. Celui-ci, financé par l’Etat, a vu grandir son déficit budgétaire et les moyens alloués sont nettement insuffisants pour garantir des travaux de recherche conséquents et pertinents. A la fin des années 90, tandis que l’enseignement supérieur international prenait des mesures phares en faveur de l’évolution moderne du nouveau millénaire, l’UCAD piétinait avec des programmes de réformes confuses et une gestion des conflits de plus en plus difficiles à contenir.
En juillet 2003, Abdou Salam Sall est nommé recteur de l’UCAD. Spécialiste de l’enseignement supérieur, Abdou Salam Sall a été doyen de la Faculté des sciences et techniques et secrétaire général du Syndicat Autonome de l’enseignement supérieur du Sénégal (SAES). C’est donc en connaissance de cause et fort motivé qu’Abdou Salam Sall prend ses fonctions à la tête de l’UCAD. Il va mettre sur pied un chantier de réformes importantes pour un meilleur fonctionnement du pôle universitaire de Dakar. Fort de ses atouts d’universitaire précis et compétent, et entouré d’une équipe expérimentée, Abdou Salam Sall propose un plan de travail managérial de l’UCAD selon quatre axes : la Qualité, la Pertinence, la Coopération et les Finances et la Gestion. Pour compléter ce plan, il suggère également de développer les nouvelles technologies de l’information et de la communication au sein de l’UCAD et d’offrir un service optimisé et performant aux étudiants. Le chantier ainsi posé, le travail peut commencer.
Améliorer la qualité de l’enseignement de l’UCAD se décline en plusieurs propositions : définir des programmes universitaires qui incluent du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-devenir en mettant l’accent sur la pédagogie universitaire. C’est aussi diversifier l’offre d’enseignement, à la fois en développant des cursus scientifiques et technologiques pointus mais aussi proposer des formations professionnalisantes pour permettre une meilleure intégration des diplômés dans le tissu économico-social du Sénégal. Pour compter sur la place de l’UCAD dans l’espace universitaire mondial, il s’agit également de mettre en place la réforme Licence-Master-Doctorat pour permettre aux étudiants d’avoir des équivalences à l’échelle internationale. Un chapitre est également proposé pour développer la formation continue des salariés, ce qui permet à ceux-ci de se former dans les meilleures conditions et par le même temps de renforcer les capacités financières de l’UCAD. Enfin, il est préconisé de consolider les conditions de travail des personnels et de maintenir les infrastructures en bon état de fonctionnement.
L’axe de la pertinence propose de développer la recherche universitaire. Celle-ci permet un meilleur rayonnement de la faculté, une amélioration des contenus et des enseignements scientifiques et engage une valorisation du travail des enseignants pour une promotion croissante. Elle propose encore d’accroitre ses partenariats (Etat, OIG, collectivités locales, ONG, organisations professionnelles, entreprises, etc.) et d’offrir un service d’expertise en matière d’enseignement. Cette perspective amène tout naturellement à l’axe de la coopération qui a pour objectif de travailler à renforcer les échanges Sud-Sud ainsi que toute alliance internationale. Celle-ci se fera notamment à travers la diffusion du site Internet de l’UCAD.
Le chapitre du financement et de la gestion des finances se décline en plusieurs branches : les finances d’Etat et les dépenses salariales doivent être réajustées. L’accent sera donc mis sur les recettes privées avec la rentabilité des infrastructures, le patrimoine immobilier, les collectivités locales, les entreprises, la vente d’expertise, la coopération internationale, la création d’une fondation de l’UCAD, les droits d’inscription, etc. Une mutation de gestion des dépenses est préconisée ainsi qu’un contrôle financier rigoureux des recettes et des charges.
Favoriser l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et encourager l’enseignement de l’informatique est une option phare de la réforme engagée par le nouveau recteur. En effet, l’UCAD doit mettre en œuvre cette formidable ouverture d’information et de développer des outils de recherche documentaire en proposant un dispositif fiable qui permette une communication performante, à la fois interne et externe. Enfin, un service d’accueil renforcé des étudiants est proposé afin de mettre en place des tutorats, de proposer des emplois, de créer des centres spécialisés et variés qui feront de l’université un pôle attractif de vie, de travail et de recherches.
Tous ces axes de travail seront minutieusement analysés et nécessiteront bien sûr l’ouverture de chantiers connexes dont le ressort systémique sera parfois un frein au changement.
Le processus de réformes engagé par Abdou Salam Sall et son équipe est à la hauteur des défis à relever pour l’enseignement supérieur du Sénégal au 21ème siècle. Mais comme le souligne son auteur, il faut être prêt à interroger en permanence ce processus et savoir à tout moment le remettre en cause. Remédier, comme en matière pédagogique, évaluer les écarts, avaliser ce qui fonctionne et ajourner ce qui conduit à l’échec. La vision d’Abdou Salam Sall a été la plus large possible afin de permettre une modernisation du système qui doit sans cesse être en capacité de changer. Observer l’enseignement supérieur dans sa globalité, analyser comment il s’organise à l’international et adapter un programme à une problématique sociale et nationale est possible si l’on considère les réalités et les intérêts du pays. Ce que qu’a réalisé Abdou Salam Sall.
Le savoir, la science, les technologies sont au cœur du monde moderne du 21ème siècle et l’Afrique doit contribuer à l’exploitation de ces ressources par ses recherches et par des services universitaires efficaces et être à la pointe des dynamiques mondiales. Le travail engagé par Abdou Salam Sall à l’UCAD depuis 2003 a prouvé qu’engager une mutation, même si elle se heurte à de nombreuses difficultés, est possible à partir du moment où chaque expert universitaire, responsable de son domaine, s’engage à améliorer les conditions d’enseignement, de professionnalisation, de recherches, de gestion financière et à bien administrer les infrastructures, à proposer des innovations en matière de partenariats et à développer les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Tous ces pôles majeurs pour un meilleur fonctionnement de l’UCAD ont été exploités et mis en œuvre.
Pour exemple, la mise en place de la réforme L-M-D a permis une véritable refonte de l’enseignement supérieur au Sénégal qui s’inscrit dans une démarche bilatérale et qui tient compte des intérêts régionaux, nationaux, continentaux et internationaux. Des cursus professionnalisants ont été mis en place, dans le secteur de l’agriculture et de la pêche par exemple, deux domaines oubliés avant 2003 alors que 70% de la population sénégalaise occupent ces deux secteurs professionnels.
L’UCAD a réussi aussi à transformer son image, son rayonnement se traduit par des inscriptions croissantes en Master Art et Culture par exemple. Le travail collaboratif des chercheurs est aussi un point central de la mutation de l’UCAD. Tout comme l’exercice de la pédagogie universitaire qui doit être maîtrisée par tous les enseignants. Les échanges internes et externes sont dès lors possibles quand les services de communication sont améliorés. L’accueil des étudiants en début de cycle est également un facteur de réussite des cursus. Il est capital de réussir toute rentrée universitaire, cela est déterminant pour le parcours des étudiants. Pour une qualité toujours améliorée, il faut assurer de façon permanente une évaluation de l’enseignement et de pouvoir ajuster, s’il le faut, des mesures qui permettent l’excellence. Les enseignants chercheurs doivent travailler dans l’urgence, sentiment favorable à l’amélioration des contenus, tout en consacrant du temps à leurs travaux. Le système d’accueil des étudiants, l’équipement des infrastructures, la sécurité du campus, les conditions de travail, le développement coopératif, la gestion financière des dépenses et des recettes et l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication sont des champs importants du travail engagé depuis 2003 à l’UCAD. Le chantier est toujours bien entendu en perpétuel évolution, il n’existe aucun consensus arrêté ou définitivement adopté dans le système de l’enseignement supérieur. Mais la réforme engagée par Abdou Salam Sall a ouvert et mis en œuvre les axes principaux d’un programme de valorisation, d’excellence, d’expertise du secteur de l’enseignement supérieur au Sénégal.
La coopération entre les universités, la mutualisation des connaissances, des ressources techniques et humaines, les échanges internationaux, la création d’entreprises, de fondations, d’infrastructures doivent être au cœur du processus de modernisation de l’enseignement supérieur du Sénégal.
« Le développement des connaissances favorise plus de richesses », voici une devise dont on devra faire sienne pour les décennies à venir. Tous les acteurs impliqués dans le développement de l’enseignement supérieur doivent en prendre la mesure. Le travail engagé par Abdou Salam Sall, à la tête de l’UCAD de 2003 à 2010, est un exemple de la conduite du changement qui démontre que l’innovation au sein du système universitaire est réalisable et qu’il conduit assurément à l’émergence d’une accroissance de l’expertise scientifique, pédagogique, scientifique et humaine.
Diriger un pôle universitaire tel que l’UCAD est une charge importante qui nécessite des qualités professionnelles exigeantes, d’être un gestionnaire rigoureux et de conserver une conviction résistante à toutes les épreuves. « Les universités des pays développés se sont construites dans la durée. Chaque génération se doit d’apporter sa contribution pour les générations à venir ». Le témoignage d’Abdou Salam Sall est éclairant et s’empare de la question universitaire sous tous les angles, sans rien omettre, du temps qu’il faut consacrer à la rénovation de l’UCAD et de l’urgence à la réaliser. Son livre est un ouvrage documentaire indispensable qui doit servir aux responsables de l’institution universitaire, aux étudiants, aux professeurs, aux intellectuels, et à tous ceux qui considèrent que le savoir est une arme miraculeuse du développement durable et de la modernité.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain, enseignant chercheur
[i] Les mutations de l’enseignement supérieur en Afrique : le cas de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Abdou Salam Sall, éditions l’Harmattan Sénégal, Dakar, 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amy Niang, jeune poète de talent, vient de publier son premier recueil. 
Fuite dans le symbole, Amy Niang, éditions Acoria, Paris, 2012
 fuite-dans-le-symbole-couve-1.pdf
fuite-dans-le-symbole-couve-1.pdf
Nomadisme et renaissance
La poésie est partage et incarne l’expression esthétique des symboles. C’est ce que nous confirme magnifiquement Amy Niang avec son tout premier recueil poétique. Cette poésie s’apparente à la vie, à la germination d’une plante, à sa flamboyante jeunesse mais aussi à sa lente décomposition. Car le regard d’Amy Niang est profondément poétique, je dirai même poétiquement lucide sur l’histoire qui se déroule à notre insu. Le parcours poétique d’Amy Niang est initiatique en même temps qu’il semble chargé d’usure. Car même si on se déplace, le monde continue de creuser ses rivières d’injustices et de bâtir ses murs d’incompréhension. Le nomadisme ici poétique est superbement enraciné dans les symboles africains qui viennent se heurter aux autres lumières. L’Afrique manquante n’est pourtant pas loin de l’Asie, toute terre est comme un précipice qu’il faut dompter.
« Loin de toi,
Ma nostalgie se nourrit
De ton mythe fécond, au fil du souvenir tapageur »
Alors quand la course géographique ne suffit plus, il y a les mots qui prennent vie et les symboles qui se dessinent pour ne plus se défaire de la source poétique. Et le « lamento » s’installe doucement, pour effacer le masque des apparences, pour oublier le soleil noir qui déchire les souvenirs, pour transcender le lancinement de l’exil. Le recueil s’achève d’ailleurs sur un long poème déchirant qui confirme un regard déjà alourdi par tant de navigations éreintantes. C’est le désir du retour à l’enfance qui s’exprime, cette terre si proche mais qui s’éloigne déjà inexorablement.
« Rendez-moi mon nerf démoli
Rendez-moi le cœur de mon enfance »
Car s’exposer au monde, c’est aussi prendre le risque de trop bien en saisir les sombres contours. La fleur est ici en pleine floraison mais elle est tellement fragile qu’elle voudrait renaître pour retrouver la liberté de la candeur, la saveur de l’ignorance.
« Nostalgie rebelle des printemps trépidants
Le cœur de l’enfance se serre
Le souvenir a fait place au souci de l’âge
L’enfance peuplée de jours éternels »
La poésie d’Amy Niang exprime, avec une belle frénésie, l’émotion des mondes nouveaux, ceux que l’on cherche avec l’impatience d’une jeunesse assoiffée. L’esthétique poétique est habilement orchestrée car on perçoit des rythmes variés qui parfois chantent la joie, qui parfois se lamentent, qui parfois se désolent des mondes disparus, celui de l’enfance, celui de l’innocence. Sur le chemin de l’initiation, à la fois celui de la poésie et celui de la vie, Amy Niang nous entraîne dans un univers personnel qui s’ouvre à nos pensées. La langue possède plusieurs couleurs, elle est souvent double, rongée d’espoir et de déception, et c’est cela qui nous touche. Le mondialisme d’Amy Niang est une vraie richesse poétique car il apporte dans son sillage un éclairage singulier du mythe africain et construit les flambeaux de la renaissance.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierre Thiam, un des plus talentueux chef cuisinier de sa génération, publie un très bel ouvrage de recettes de cuisine sénégalaises. La cuisine est une partie intégrante de la littérature et des arts, la cuisine est toute une poésie qu'il faut partager.
Yolélé ! Recipes from the heart of Senegal, Lake Isle Press, New-York, 2008, Pierre Thiam Catering 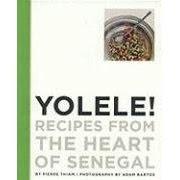
Saveurs multiculturelles
 La cuisine est un acte de créativité. Faire la cuisine est un moment de générosité où le cuisinier donne de lui-même pour faire partager sa vision du monde. La cuisine est aussi un art, un art mêlant les aliments, les saveurs, les parfums, les couleurs, un savoir-faire culturel qu’il convient de construire, de déconstruire, de reconstruire pour offrir des aromes uniques. C’est ce que nous transmet Pierre Thiam dans son très beau livre illustré Yolélé !
La cuisine est un acte de créativité. Faire la cuisine est un moment de générosité où le cuisinier donne de lui-même pour faire partager sa vision du monde. La cuisine est aussi un art, un art mêlant les aliments, les saveurs, les parfums, les couleurs, un savoir-faire culturel qu’il convient de construire, de déconstruire, de reconstruire pour offrir des aromes uniques. C’est ce que nous transmet Pierre Thiam dans son très beau livre illustré Yolélé !
La cuisine est sa passion, son métier et il y déploie tous ses talents artistiques, en y associant de minutieuses recherches pour l’élaboration des plats, leur cuisson et réaliser ainsi des associations culinaires insolites. Le parcours de Pierre Thiam est étonnant. Issu d’une famille originaire de la Casamance, élevé dans la double culture chrétienne et musulmane, il retrace son périple à travers l’art de la cuisine pour retrouver ses racines qu’il transcende au contact des mondes qui l’habitent. Ayant grandi dans un univers multiculturel, Pierre Thiam est un voyageur insatiable du temple gastronomique.
C’est exilé en terre américaine qu’il découvre son amour pour la cuisine dont il veut faire son métier. Profession pour le moins inhabituelle pour un homme dans la culture africaine. C’est aussi ce qui fait sa force, son talent, c’est sa curiosité, son audace à franchir des barrières déjà tracées. Il est aujourd’hui un chef de grande renommée à New York qui travaille en cherchant des alliances subtiles entre cuisine créole, cuisine sénégalaise et street food. Son label, Pierre Thiam Catering, propose d’ailleurs une démarche innovante dans le domaine culinaire international.
Ce livre de recettes, inspirées de la cuisine sénégalaise, vietnamienne, française et américaine, est un bel hommage à la culture panafricaine qui pour l’occasion se singularise par ses bouquets variés, ses ingrédients multiples, ses effluves enivrantes qui savent voyager. On retrouve ici le goût du beau, le désir savant d’une cuisine simple faite de fraîcheur et en même temps très élaborée. La culture sénégalaise hante les pages de ce bel ouvrage en même temps qu’elle s’envole au-delà des frontières gastronomiques. Assurément Pierre Thiam est un artiste qui célèbre le culte de la beauté à travers la charge symbolique du repas partagé assaisonné d’épices fines et culturelles. Aidé du photographe Adam Bartos, il offre des plats savoureux aux lecteurs et rend aussi hommage aux femmes de sa famille, initiatrices de son génie culinaire. Vous devez lire ce livre aux courbes généreuses qui propose un voyage multiculinaire et original. Et surtout profitez-en pour vous mettre aux fourneaux !
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain, enseignant chercheur en sciences cognitives à Paris
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Douceurs du bercail, Aminata Sow Fall, Nouvelles Editions Ivoiriennes, Abidjan, 1998 
la volonté et l’espoir
La problématique du roman de Aminata Sow Fall pourrait a priori s’expliquer simplement. Pourtant il n’en est rien. Les paradigmes qui structurent le récit sont complexes et jamais unilatéraux.
Asta, une femme sénégalaise, la quarantaine diplômée et autonome, est victime d’une injustice alors qu’elle se rend en Europe pour une conférence sur l’Ordre Economique Mondial. A travers le récit d’Asta, arrêtée par la police des frontières et transférée au « dépôt » pour être reconduite chez elle, on assiste aux interrogations du peuple africain sur les sujets majeurs qui agitent le continent noir : la mésestime de soi, l’immigration comme seule chance de survie, chargée d’illusions d’un Eldorado impossible, la corruption des dirigeants africains et l’immobilisme qui en résulte, l’incompréhension et le mépris des autorités des pays occidentaux, la dépendances des Etats africains liée aux aides internationales, au pouvoir dévastateur du Fond Monétaire International, l’inégalité monétaire, politique, économique, sociale, la dureté des conditions de l’immigration, le passé colonial qui hante les esprits et produit les pires injustices.
A travers ces questionnements, Aminata Sow Fall ne donne aucune leçon de moral mais elle propose la voie intellectuelle, celle de l’écriture, la voie humaine, l’élan de dignité nécessaire à la construction, une voix de la renaissance africaine. La construction littéraire de l’auteur est particulièrement intéressante car les personnages prisonniers du « dépôt » sont les témoins du chaos migratoire et racontent « l’enfer » de la déshumanisation. Le récit est haletant, comme une tragédie antique, au plus près des réalités contemporaines et utilisant un langage poétique qui émerge quand renaît l’espoir. A l’extérieur du cachot, Anne, une amie française de Asta, se bat pour démêler l’imbroglio teinté de racisme primaire et l’injustice faite à sa « camarade ». Militante et convaincue de l’innocence de Asta, elle se heurte à la rigidité administrative, aux mensonges des diplomates, aux fausses promesses. Pendant ce temps, le drame continue de se jouer dans l’enceinte du « dépôt ».
Anne aussi rêve d’un monde meilleur pour former une ronde humaine et solidaire. C’est ce désir très fort qui unit les deux femmes si différentes et si semblables à la fois. C’est dans cette tentative d’harmonie féminine, de combat et de partage que prend toute sa dimension le récit de l’auteur. Car Aminata Sow Fall est une médiatrice qui, par sa belle plume, fait passer une autre image de l’Afrique, celle des traditions, de l’intelligence, de la dignité, de la beauté, de l’énergie à combattre les injustices.
Dans l’épilogue du récit où Asta retrouve enfin la liberté, la blessure est vive mais elle n’est pas brisée. Et comme cadeau, elle reçoit une terre africaine qu’elle va aménagée, cultivée pour la postérité. C’est le retour à la terre des ancêtres, loin de la cruauté de la ville, loin de l’illusion destructrice des côtes européennes. Les Douceurs du bercail sont les richesses qui émergent de la terre de l’Afrique si l’on se bat, si l’on y croit, si le rêve est intact et que l’on transforme le savoir en abondance et que l’expérience devient sagesse.
Le roman de Aminata Sow Fall est l’expression de la force, de la confiance sereine, de la beauté, de la vérité, de la lumière de l’Afrique, éléments essentiels de la Renaissance Africaine et de la conscience historique du peuple africain.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le chapelet de rêve, Habib Demba Fall, éditions Acoria, Paris, 2007 
Le chapelet de rêves ? Des paroles d’espoir tissées, de mélopées sacrées enfilées, que le poète Habib Demba Fall égrène une à une dans ce beau recueil. Au fur et à mesure qu’on lit les poèmes qui composent ce recueil bien écrit, on partage les doutes et les interrogations de l’auteur dont le cheminement poétique est plus que prometteur. Au-delà des belles images et du message délivré, la singularité de l’écriture de Habib Demba Fall tient dans la structure originale du recueil et du rythme des textes qui se répondent en écho. L’autre grande qualité est que l’ensemble n’est pas refermé sur lui-même, au contraire il ouvre les portes d’un univers poétique à la fois singulier et universel. La parole du poète se fait entendre et il s’engage dans un vrai dialogue avec le monde qui l’entoure et du coup il parvient à une connivence sensible et intelligente avec le lecteur.
« Je n’ai moi-même
pas les mots
pour faire aimer la vie
J’ai laissé mes seuls miracles
dans mon dernier rêve »
Le Chapelet de rêves est un recueil abouti où l’on admire le travail de créativité poétique. Habib Demba Fall a une personnalité « vraie » mais sa sincérité n’entame pas son exigence de la grande poésie. Il émeut avec des images fortes, des images de souffrance qu’il combat. Mais il avoue ses faiblesses, des doutes, sa solitude et c’est ce qui fait la beauté de la quête de l’homme, donc du poète.
« J’ai guetté la Vie
prière furtive sur les miettes
J’ai supplié l’Amour
la Haine est la plus forte
J’ai supplié la vie »
Par le truchement d’un soliloque savamment orchestré, le dialogue n’est pas achevé, il peut se poursuivre à travers d’autres textes à venir. La force du recueil vient aussi de la construction : des préambules magnifiques qui annoncent les textes mais avec d’autres mots et sous une forme surprenante. Puis les quatre parties qui guident le lecteur tout au long du parcours initiatique du poète. Et les textes qui achèvent chaque partie qui sont comme des respirations oniriques. Enfin, il y a la langue, soigneusement travaillée, rythmée par une belle poétique. Les textes ressemblent à des mélopées sacrées, des cris qui réveillent la conscience de tous.
« Et demain
demain les vertes pépinières d’Humanité grande
Mais où prendre la houe d’espoir Néant
comment vaincre cette ombre »
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mangrovines, Poésie, Racine Senghor, éditions Sagnanème, Dakar, 2011 
Les textes qui composent ce recueil portent en eux une respiration féconde qui enrichit la poésie négro-africaine. L’empreinte poétique réunissant le sens esthétique de la langue et l’émotion est parfaitement maîtrisée par Racine Senghor. L’ode à la terre est ici transcendée, portée par des images d’amour singulières et par une fantastique exaltation sensuelle.
« Me voici de nouveau trempé
Sous tes racines qui baignent
Fécondes les ondes lentes,
Lisses ondes des veillées dorées »
Le poète, nomade solitaire, surgit tel un génie qui s’émerveille des beautés naturelles et s’approprie les mots du paysage de l’instant, créant ainsi une fibre poétique inédite et fascinante.
« Je me promène dans mon champ
D’étoiles, vaste
Las et heureux, tout à ce rêve
Qui m’a surpris
Sous la lune
En canicule
Etendu »
La communion poétique du recueil est cette force avec laquelle l’artiste peut dire ce que chacun voit, ce que chacun entend. Le poète Racine Senghor est le passeur de nos rêves, de nos questionnements, de nos colères, de nos splendeurs vivantes qui rythment notre regard. Mangrovines bat à la cadence d’un cœur poétique langoureux et savant qui dénote un tempérament d’une totale générosité littéraire. La recherche métaphorique est en harmonie avec les intentions textuelles, avec le son de la langue qui résonne de couleurs, de bruissements et d’une atmosphère baignée de lumières perlées d’un lyrisme féérique et élégant. Le grand talent de Racine Senghor est de pouvoir transformer le lecteur en celui qui compose. La liberté de sa poésie réside en cette incroyable vision, précise, belle et immédiate, qui fait de ses textes des champs poétiques pluriels qui ondulent au tempo de sa voix délicate, initiatique et lumineuse.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le chant des blessures, Pulcherie 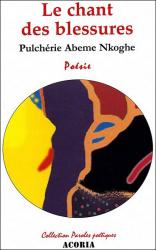 Abeme Nkoghe, éditions Acoria, Paris, 2008
Abeme Nkoghe, éditions Acoria, Paris, 2008
 D’une belle simplicité, la poésie de Pulchérie ABEME NKOGHE interroge la nature humaine avec force et innocence. C’est cette alchimie du verbe et des symboles qui traverse le recueil de la poétesse gabonaise. A travers son langage singulier, elle parvient à imposer son univers qui questionne le monde sans brutalité. Elle est aussi à l’aise avec les images de l’enfance qu’avec celles de la conscience du monde noir ou celles de la complexité des êtres ou encore celles de l’amour. Elle porte un regard sur les injustices, la souffrance, la colère, sur ceux et celles qui croient posséder la vérité avec l’étendue de son absurdité, sur les discriminations à l’égard du peuple noir. Au-delà de cela, elle nous entraîne, de manière séduisante, vers la culture africaine, ses racines qui sont les siennes, son attachement aux autres, hommage aux proches, aux amies, aux mères, à l’amour qui équilibre et rend meilleur.
D’une belle simplicité, la poésie de Pulchérie ABEME NKOGHE interroge la nature humaine avec force et innocence. C’est cette alchimie du verbe et des symboles qui traverse le recueil de la poétesse gabonaise. A travers son langage singulier, elle parvient à imposer son univers qui questionne le monde sans brutalité. Elle est aussi à l’aise avec les images de l’enfance qu’avec celles de la conscience du monde noir ou celles de la complexité des êtres ou encore celles de l’amour. Elle porte un regard sur les injustices, la souffrance, la colère, sur ceux et celles qui croient posséder la vérité avec l’étendue de son absurdité, sur les discriminations à l’égard du peuple noir. Au-delà de cela, elle nous entraîne, de manière séduisante, vers la culture africaine, ses racines qui sont les siennes, son attachement aux autres, hommage aux proches, aux amies, aux mères, à l’amour qui équilibre et rend meilleur.
Pulchérie ABEME NKOGHE dénonce les puissances financières mensongères qui méprisent les valeurs humanistes, seules sources de la construction humaine. Elle sait aussi porter un regard sur elle-même en mettant à l’épreuve sa propre conscience, ses propres faiblesses. Elle dit aussi les ravages de l’homme sur la nature et la défense que celle-ci peut produire sans prévenir. En cela, son message est clair : les éléments de la terre sont puissants, parfois incontrôlables mais ils sont également source d’espoir, de rêves et de liberté.
L’atelier de création de la poétesse se forme et permet l’inspiration autour de thèmes existentiels, autrement dit universels et intemporels. L’écriture est spontanée, généreuse et n’est pas travestie de faux sentiments. Nous assistons à la naissance d’une jeune poétesse et en cela nous devons l’encourager à persister dans cette authentique et douce ténacité. Quand Pulchérie ABEME NKOGHE chante la négritude, il nous vient à l’esprit que la couleur ébène est belle, symbole de force et de dignité. Elle construit cette conscience identitaire qui permet à l’être d’exister pleinement dans son appartenance originelle. Il faut lire le recueil de Pulchérie ABEME NKOGHE comme une bouffée d’air pur, tel un « chant des blessures » qui dit mais ne renonce pas. La créativité est une ronde arc-en-ciel qui réunit les êtres, la poésie de Pulchérie ABEME NKOGHE est un des maillons de l’union poétique et humaine.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les travaux d’Ariane suivi de Destins et de Quelque part en ce monde, Caya MAKHÉLÉ, théâtre, éditions Asphalte, Paris, 2006 
Scènes de folies quotidiennes
La tragédie humaine souffle sur le théâtre de Caya Makhélé et le dramaturge nous offre une perspective à la fois contemporaine et éternelle de la folie des hommes. Ces courtes histoires lacérées au couteau s’inscrivent dans une littérature énigmatique et implacable cherchant en vain la lumière. Les personnages sont tour à tour victimes, coupables, témoins de la bêtise meurtrière qui saisit l’être adulte et anéantit l’innocence qui berce l’enfance, même la plus malheureuse. La mise en scène est crue, éclairée de désespoir mais c’est cette densité néo-réaliste qui frappe le lecteur. La langue se libère des carcans hypocrites et révèle la puissance des mots d’une authenticité féroce.
Les travaux d’Ariane présente un monologue poétique et cruel d’une femme brisée par la mort de son enfant, tué par la main du père, un homme destructeur et avide du pouvoir qu’il exerce. Les lumières s’attardent sur l’ambivalence d’un monde moderne, la nostalgie de l’enfance, des valeurs oubliées et des gestes tendres maternels uniques et rares. La solitude du monologue fait aussi surgir le terrible constat de la cellule familiale rompue. Pour continuer de vivre, Ariane se fait mante religieuse et assassine l’homme par sa féminité la plus intime avec au ventre la « peur de la mort de l’amour ».
Dans Destins, un boxeur atteint d’une tumeur au cerveau voit défiler ses souvenirs. La mémoire est incarnée par une femme qui fait émerger la conscience de l’homme. Finalement, celui-ci pourrait être mort, ressuscitant ainsi des ténèbres pour reconnaître ses fautes et ses faiblesses. C’est un tableau métaphorique de l’oubli décrivant le coma d’un homme qui se refuse à regarder la vérité en face. L’écriture de Caya Makhélé fait entendre un blues amer, fait d’images mythiques détruites mais toujours vivantes au plus secret des êtres. Les personnages s’accrochent au meilleur d’eux-mêmes, aidés de leur vision d’un monde qui les a trahi mais qu’ils veulent reconquérir. Emprisonnés par l’argent, l’alcool, le pouvoir, ils cherchent les soleils essentiels comme des pantins fatigués. Des obstacles les font trébucher telles des épreuves symboliques pour atteindre la liberté ou la mort.
Quelque part en ce monde met en scène quatre acteurs d’une tragédie qui place chacun prêt à « affronter ses fantômes ». Une guerre, des massacres, un charnier, des morts et des vivants qui s’affrontent pour faire surgir l’horreur de la vérité. Lâcheté, ignominie, traîtrise sont au cœur de ce jeu irréel et inhumain. Des scènes rouges de sang entre les coupables et les victimes qui forment des couples improbables. Les dialogues de Caya Makhélé sont hantés de mélopées tristes d’hommes et de femmes fracassés mais ils dévoilent leur dimension charnelle en les initiant à la douleur, aux cauchemars de l’amour, à la trahison et à la mise à mort de leurs âmes. Leur conscience les oblige à assumer leur responsabilité à travers le prisme insurmontable du cycle de l’existence et de la destruction. Ces êtres de chair et de sang sont l’incarnation d’une faiblesse mortelle mais aussi l’espoir d’une renaissance nouvelle. Il n’y a pas de repos sans condamnation des vrais coupables, que l’on soit bourreau ou complice. À travers ces histoires, l’œuvre théâtrale devient intemporelle, suspendue en chacun de nous car terriblement humaine.
Amadou Elimane Kane, poète-écrivain
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Prophète ou le cœur aux mains de pain, poème-chant, Amadou Lamine Sall, éditions Feu de brousse, Dakar, 2005. 
Ode humaine et spirituelle
C’est sous la forme d’une incarnation humaine que le poète a choisi de chanter le prophète ou joliment titré « le cœur aux mains de pain ». Paroles d’espérance, de foi qui revient à dire que l’homme doit s’aider de la pensée sacrée pour vivre pleinement. Magie de l’invisible, présence inexpliquée de celui qui rend grâce à la générosité humaine.
Impossible « création » artistique car l’écriture, dit le poète, reste insuffisante pour partager sur terre la force de Dieu. Icônes déformées, prophéties décalées, l’artiste proclame un regard dépassant le chaos, abolissant l’orgueil des fidèles et le fanatisme archaïque. Privilégiant la « Totale Connaissance » des sourates, inépuisable source de savoirs légendaires, archives de l’histoire de l’humanité incarnée dans Ses paroles éternelles. La quête du poète est un appel à Dieu pour ramener les hommes vers de plus sages vertus teintées de chair, de désir et de l’amour pur et secret.
Poème-chant de l’homme qui s’interroge sur la transcendance des mots pour parvenir à la réunification de l’être et de l’esprit. Sage parenthèse ou préférences plurielles, le questionnement n’apporte que des réponses éphémères que le poète rend universelles. Ode à la vie et au partage sans calcul, telle semble être la profession de foi de Amadou Lamine Sall. Bien que condamné à l’impossible transmission, par son art de la langue, le poète nous fait partager sa ferveur personnelle dans nous enrôler ou nous abjurer. Défi poétique et sacré qui touche le cœur de l’esthétique et la fibre artistique.
Amadou Elimane Kane, poète écrivain
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’écho des jours, Hamidou Dia, éditions Panafrika / Silex / Nouvelles du Sud, Dakar, 2006 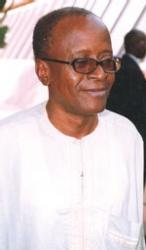
L’écho des jours d’Hamidou Dia est un recueil ciselé, réunissant les paroles essentielles, celles de la mémoire, de la communion et de l’amour de l’Afrique, la terre d’enfance. Le poète se souvient et à travers ses réminiscences il trace le passé, le présent et l’avenir commun à tous les hommes. C’est une poésie de la mémoire, des racines fertiles, de la rencontre de deux langues, des particularités culturelles et des richesses humaines, comme le précise l’écrivain Cheikh Hamidou Kane dans sa préface. Le premier texte du recueil, dédié à Aimé Césaire, est le lien puissant, poétique qui relie la terre d’Afrique aux déportés des caraïbes. À travers le souffle d’Hamidou Dia, le continent premier reconnaît ses enfants esclavagisés. Long chant lancinant des souffrances endurées par le peuple noir et prière transatlantique dans l’espoir d’une unité retrouvée. Puis la mélodie du retour au pays natal commence.
« Me reviennent des nostalgies anciennes
Qui habitent ma mémoire comme une antienne. »
C’est la poésie de l’enfance, de l’héritage culturel, du patrimoine historique, de la terre natale le Fouta, de ses rites et de ses croyances. Belle terre de lumière et d’images fécondes, sources d’inspiration du poète.
« Ah ! Teddungal,
Ngal Teddungal
De nos terres feu de brousse
Dans la saveur ocre du couchant […]
Je reviens des chemins escarpés
Vers les hautes herbes de ma savane
Me rouler dans les nénuphars argileux
De nos terres de patience. »
Puis la pensée pivote sur son axe, se détourne vers les images brumeuses du « pays lointain », depuis la terre d’Europe, teintées de l’exil. De retour « sur l’autre versant », Hamidou Dia contemple le paysage et ses rugosités. L’espoir se transcende à travers la commémoration des luttes, de la liberté et « de nos volontés sans vacillement. » Le poète chemine avec le temps, le monde entier a le sourire de l’Afrique. Symbole de l’amour, de l’eau rare et généreuse, de la mère nourricière, des femmes africaines.
« Nostalgies anciennes
Me reviennent
Parmi la rumeur de la mer
Qu’enlace le double fleuve […]
Tu es fleuve et latérite
Ndatté Yalla au zénith d’Aliine Sitoyé ! »
Le poète chante la sœur chérie, le double amoureux, le mystère féminin :
« Salysba
Tu es la poésie du Soleil […]
Salysba
Que m’abreuve l’humidité cristalline
De tes yeux de jasmin bleu »
Belle magie du passé qui se réveille, illuminée de la puissance terrestre naturelle et des ancêtres.
« Soleils
Des fleuves
Aux fleurs des tamariniers
Tamariniers
Qu’habitent les génies de la haute antiquité
Antiquité
Aux murailles de savanes
Qui abritèrent mes pères »
Souvenance du Fouta, région de l’enfance où la vie fourmille.
« Pays lointain
Qui vient de si loin
Me reviennent
Les senteurs de brousse
Des terres ocre qui fument […]
Me reviennent les festins rituels
La théorie des jeunes filles parées
Le long des rivages de mélancolie
La rhapsodie des griots »
Le poète a souffert sur les routes de l’ailleurs, « loin des matins de paix ». Il revient réconcilié avec sa terre, se libérant de l’imposture.
« Ô mon peuple
Ô peuple mien
Venu de si loin
Je suis revenu du séjour fuligineux
Sous des « jours étrangers »
Dans la poussière de vaines illusions
Et l’amnésie de la genèse
Retrouver le secret oublié
Et l’origine perdue. »
L’Écho des jours d’Hamidou Dia est une longue déclaration, un hymne à l’amour, à la tolérance, à la sagesse retrouvée, un cri lancé pour que s’accomplisse la Renaissance africaine.
« Des gloires à venir
Se lèvera
Le premier matin d’une humanité nouvelle
Et de paix. »
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faubourienne, Abdoulaye Fodé Ndione, Les nouvelles éditions Africaines du Sénégal, Dakar, 2005 
Le recueil de Abdoulaye Fodé Ndione sonne comme un bel hymne à l’amour et à la beauté. Les mots du poète sont stylisés et symbolisent l’espoir à travers cette déclaration poétique et amoureuse.
« Je te cherche source de mes chants éperdus
depuis ma voix masculine
Je te cherche sur la scène des vérités
qui tremblent à notre fermeté
Je te cherche pour le refus du regret
de la joie éprouvée […]
Je te cherche pour fermer les portes
de nos yeux chargés d’attente. »
Le souffle esthétique de la langue est puissant et le rythme imposé sans respiration fait la force du texte. Mais cet aveu amoureux va au-delà du cercle intime, l’auteur cherche l’union humaine au sens universel.
« Nous nouerons les cœurs
noirs
blancs
jaunes
rouges
pour le noir-blanc-jaune-rouge
par le regard solide de l’espérance »
La force poétique provient de cette lente ascension qui débute comme une ode à l’amour, à la femme et qui s’achève sur une note plus vaste, celle d’un monde pacifié qui est le symbole de l’espérance et de la liberté.
« Viens vite
à nous deux nous serons force
je prendrai le flambeau de paix
je ferai le tour des races
et les barrières cartonnées des prééminences
brûleront à la découverte de l’amour »
Ici, les mots de Abdoulaye Fodé Ndione trouvent leur existence dans l’exercice d’une poétique transcendée doublée d’un esthétisme maîtrisé.
« Je te cherche partout
dans l’aveugle émotion
et quand je te retrouve
mes doigts dansent
mes jambes se cherchent
ma voix se replie de balbutiements
et je revis à ta parole
comme un ressuscité de la hantise »
La poésie de Abdoulaye Fodé Ndione est belle car les images sont inspirées par l’autre, symbole de la création originelle. Ce recueil abouti inspire l’éclatante vigueur de la Renaissance Africaine.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Œuvres poétiques complètes, tome II - Fragrances, Nouréini Tidjani-Serpos, éditions Acoria, Paris, 2006 
L’expérience poétique deNouréini Tidjani-Serpos est un long fleuve littéraire dont le lecteur se sent le complice. Nouréini Tidjani-Serpos est un homme libre et il le fait savoir. Il ose toutes les formes entre prose et poésie, il contorsionne la langue et nous délivre des messages personnels et universels d’une grande puissance. Il n’y a pas de place pour le masque superficiel de l’écriture, Nouréini Tidjani-Serpos écrit avec les matériaux de la vie, les exposant au plus grand nombre et formant ainsi des évidences mais aussi des questionnements. Nouréini Tidjani-Serpos n’est pas un enfant sage, il est un poète rebelle qui dérange la forme et refuse le conformisme.
« Toutes les fois où mes amis linguistes
Me parlent d’interférence
Je leur ris au nez.
J’ai besoin de mots nouveaux
Pour exprimer les réalités de mon temps »
La poésie de Nouréini Tidjani-Serpos se lit comme des éclats fulgurants mais également dans la douceur de la chronique philosophique.
« Il faut qu’une culture ait un visage. Je ferme les yeux, je suis masque. (…) Et le tam-tam fait l’amour au balafon. Et si, en réalité, une culture c’était aussi une façon de produire et d’entrer en relation avec les autres. »
Le poète s’amuse des évidences de l’un pour enrichir son imaginaire, celui-ci n’est pas figé car le monde possède des résonances multiples.
« Chez nous
Il fait si chaud
Que les hirondelles
Annoncent en permanence
Un temps chaud humide.
Chez nous
L’hirondelle
N’annonce jamais
Le printemps »
Tout comme le poète n’hésite pas à combattre avec les mots, il s’engage sans détour dans la voie de ce qui est injuste, ses textes ont des humeurs, des couleurs de colère.
« Nous autres, nous en avons assez des élucubrations sans lendemain. Ce que nous voulons ? Réinventer le ciel. Ce que nous exigeons ? La fin de la mascarade culturelle. En langage des sciences politiques africaines cela s’appelle de la subversion. »
La parole bouscule avec une incroyable force. C’est que Nouréini Tidjani-Serpos ne se laisse jamais prendre à son propre piège poétique, il ne contemple pas son miroir, assouvi de sa belle créativité. Il construit et déconstruit comme tous les grands poètes.
« Les gens aiment tellement
Vous définir, vous cataloguer
Vous numéroter, vous estampiller
Que j’ai l’orgasme
Chaque fois que l’on dit de moi
Qu’on ne me comprend pas. »
Le poète s’amuse aussi parfois et le regard qu’il porte sur le monde qui l’entoure est une intelligence moqueuse qui pétille.
« Il fait chaud
Vous ne trouvez pas ?
Il fait chaud
Dans la canicule africaine
Et avec
Nos maigres devises étrangères
Mon cousin le Ministre
A commandé de la laine
Un complet-trois-pièces en laine. »
Dans L’ancêtre a dit (I) et (II), le poète raconte comment enfant il posait des questions à son grand-père. Celui-ci ne répond pas, il démontre comme un chercheur scientifique qui a appris à cohabiter avec la nature. Texte magnifique où en si peu de mots, tout est dit.
« Nous sommes rentrés chez nous, après une semaine d’observation. Vous avez compris ? Après cette leçon de choses qui m’a fait gagner une semaine de cours. Je n’ai plus posé de questions idiotes à mon grand-père. »
Puis l’émotion gagne de nouveau les pages du recueil, la poésie de Tijani-Serpos est ainsi, surprenante, sans schéma rigide, elle est liberté de ton et émerveillement. Le poète guide de ses mots mais le lecteur est compositeur de sa propre musique intérieure.
« Le jour viendra
Mes amis
Où l’étranger en nous
Ne sera plus étrange.
Le poète possède cette capacité à nous faire partager ses questionnements les plus simples qui deviennent les plus poignants, ce qui constitue l’essentiel de la vie des hommes. L’écriture de Nouréini Tidjani-Serpos est tour à tour provocante, émouvante, nostalgique et le poète partage son univers sans duplicité. Il est un passeur de mots et d’émois. Comme il le dit lui-même, son style est inclassable et de cela il en fait une force car ses textes nous touchent au plus profond. Ses textes représentent chacun une histoire qui marquent nos esprits, on sourit, on est ému, on apprend.
« Chez moi, les « oranges » ne sont pas oranges et je ne le savais pas. Chez moi, les « oranges » mûres sont vertes ou jaunes et je ne m’en étais pas rendu compte. Allez donc expliquer la couleur orange en donnant à un enfant une « orange » qui ne serait pas mûre parce que Verte. Allez donc expliquer la couleur orange en donnant à un enfant une « orange » verte ou jaune. Ce rébus vous apprendra à utiliser la langue des autres pour exprimer vos réalités tropicales. »
Et voilà la poésie de Nouréini Tidjani-Serpos, tout paraît simple et pourtant tout est chamboulé. Cependant, l’auteur se garde bien d’expliquer, de rationaliser car comme il le dit de belle manière et tout naturellement dans « Le Non-dit poétique » :
« Le poème se trouve
Dans la tête de celui qui le lit
Qui l’invente avec l’expérience de sa vie
Qui le nourrit de ses fantasmes
Et lui prête sa vision et sa passion
Le poète n’est qu’un médium.
Car le vrai auteur du poème
C’est toi »
Nouréini Tidjani-Serpos est de la veine des « grands » dont il partage le talent, l’émotion, la sensibilité humaine, l’intelligence, la proximité avec le lecteur. Il est de la race des seigneurs, tels Aimé Césaire, Marcel Proust, Birago Diop, Antonio Lobo Antunès, Pablo Néruda. En lisant l’œuvre de Nouréini Tidjani-Serpos, vous êtes transportés, transformés, vous vous êtes re-découverts. La poésie de Nouréini Tidjani-Serpos devient patrimoine universel, elle est incontournable.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les ombres de la nuit, Paul Dakeyo, éditions Nouvelles du Sud 
poésie de l’éternel
Paul Dakeyo a choisi de s’asseoir, d’ouvrir sa fenêtre sur le temps et sur l’espace. Il nous invite à un voyage toujours engagé mais certainement moins escarpé. Ce sont les saisons qui rythment la parole du poète :
« Maintenant je m’enferme dans la maison vide
Les volets clos
Je m’enferme avec ma parole bruissante
Et le chant que je porte comme une complainte
Quand la lumière éclaire mes larmes »
Il s’assoit donc et prend le temps de regarder en arrière : la douceur de l’enfance, la terre natale toujours martyrisée, le peuple noir enchaîné, la femme disparue, les enfants qui rappellent à la vie. La vie rêvée de la terre perdue au-delà de l’océan et celle qui s’est construite, de force, sur la terre d’adoption où les racines se sont entremêlées à l’identité ancestrale, aux souvenirs indicibles qui déchirent. Ce témoignage de questionnement existentiel parle à chacun d’entre nous :
« Seule la mort sera un exil »
Cette étape qui réunit les hommes où qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, quelque soit leur vie, leurs souffrances. Mais le poète n’oublie pas les chaînes, les prisons de la terre mère Afrique. Elles ne sont pas juste des symboles, celles plus métaphoriques de l’exil, mais encore dévolues à tous les combats. Paul Dakeyo nous entraîne dans sa quête de la mémoire, sur les traces poétiques de l’enfance mystérieuse, magnifiée par l’alliance grandiose de l’éloignement spatial et temporel. C’est ce même sentiment qui se mêle à la nostalgie de la terre géographique abandonnée par le départ qui dure, qui dure.
« Mais vivre ailleurs c’est subir une violence
Celle de l’exil solitaire »
Alors les mots jaillissent comme une seconde respiration pour ne rien oublier, à la recherche de ce temps perdu proustien, si proche de l’écriture du poète :
« Le temps se déchirera
Jusqu’à la transparence du matin
Il le faudra
Je saisirai la lumière
Par delà les murailles de l’ombre
Par delà l’oubli pour retrouver
Le visage du temps qui nous habite»
Puis avec les mots de l’amour blessé, il invite l’autre dans son antre, complice, pour comprendre, pour ne pas être seul :
« Dis-moi mon amour
Comment feras-tu
Pour que ce sans versé par tous les frères
N’ait plus cette odeur putride du destin confisqué »
La force de la poésie de Paul Dakeyo, c’est qu’elle est à la fois universelle et singulière. Il est un enfant africain, un poète engagé exilé, un homme qui souffre de l’amour enfui, qui guette la marche du temps incompressible, la mort et la solitude rôdent :
« Il faudrait peut-être mettre la plume de côté
Ce soir la solitude et l’isolement me pèsent
Surtout ne t’en fais pas pour moi pour toi pour nous
Le temps fera et défera les choses
Tu restes ce qui pouvait m’arriver de mieux
Ton empreinte partout
A tout à l’heure je vais dormir
J’ai mis ta photo près de mon lit
Epinglée à hauteur de mes yeux
Je t’embrasse et te caresse »
Déclaration d’amour à la femme, à la terre éloignée, tout cela ne fait qu’un. La disparition si justement évoquée par Georges Perec : la lettre E, la mort, la famille déportée, le génocide juif. Paul Dakeyo est proche de cette famille d’écrivains, il transcende l’infiniment petit à la grandeur de l’histoire du monde. Les saisons défilent et seul dans la maison déserte, le poète parle à l’être aimé, à la femme absente :
« La liberté a repris ses quartiers
L’amour commence ici
Et le reste n’est qu’éternité
Où es-tu
Même les murs de la maison
Contemplent le printemps »
C’est un long chant qu’entame le poète pour marquer éternellement l’amour unique :
« Vienne le temps primordial
Où la mémoire est un rêve
Qui engendre le jour
Le vent le sable
Le silence des eaux
C’est tout ce que nous aurons
Mais la mémoire porte une autre île
Pour que la rencontre se fasse
Entre hier et aujourd’hui
Dans l’étincellement du jour
Au terme de nos corps»
Puis soudain, comme on sort de la nuit, le poète a retrouvé le temps :
« Tu es ce pays de clair silence
Où la lumière du soleil m’a permis
De me soustraire à la nuit
Pour me river au jour qui te compose
Mais d’où viendra le chant
Maintenant que je sais que rien ne pourra
Nous exclure du temps
Et que la grisaille des jours anciens
Ne pourra nous meurtrir »
Les ombres de la nuit est un long poème d’amour d’une facture littéraire poignante, lancinante, sensuelle. Le poète ne cesse de déclamer son amour intact, ses errances solitaires. Malgré l’enveloppe poétique, le temps de nouveau s’est perdu :
« Je chercherai longtemps la terre
Celle qui m’asile d’écume ardente
Jusqu’au prochain printemps
Et je glisserai dans la neige l’espoir
Qui s’éprend de mon chant
Sanglot qui se ferme dans le sillage du jour
Et ton visage deviendra
Ces seuls fragments de murs barbelés
Où s’inscrivent le signe de l’érosion
Et les stigmates du temps perdu
Puis au fil du poème, Paul Dakeyo retrouve ses racines, « Bafoussam est ma ville », le chagrin de l’amour s’estompe pour laisser place aux « grandes mains fraternelles » de la terre exilée, il scande à l’envie :
« Je suis un NEGRE SILEX tu le sais
Dans LES OMBRES DE LA NUIT »
Et le retour vers la terre natale peut commencer. L’amour enfui est partout, dans le ciel à l’infini, masque de la mémoire. Une fois la géographie africaine retrouvée, il souffre de l’exil de la femme disparue mais le poète a retrouvé la vérité. Puis, un nouveau visage se dessine, nouveau temps, nouvel espace, nouvelle géographie féminine et nourricière. Avec elle renaît l’espoir, l’homme se relève et tel un immortel, il déclare :
« Je parlerai du corps et du désir
Pour élever ma voix au milieu des miens
Sur l’asphalte noire du nord
Je veux nommer avec mon langage nu
Les faux frères nègres blacks macoutes
Je veux nommer la terre les odeurs les scènes de ménage
Les histoires et les légendes tout ce qui se fixe
Notre identité
Pour que nos mots murmurent en osmose
Avec le monde
Il faudra s’ouvrir et se dépasser
Dépasser l’ethnie le pays le continent
N’être que ton homme couleur de nuit
Pour que tu t’ouvres enfin
Comme un grand poème »
Les Ombres de la nuit n’est pas seulement un « chant-poème », c’est un grand livre qui rejoint la bibliothèque de Babel.
Amadou Elimane Kane, Poète écrivain